|
|
Dossier
spécial ISS :
Partie 3: l'anatomie
de la station
La Station Spatiale
Internationale devra répondre à des exigences bien
particulières qui ont largement contribué à
la finalisation de son architecture.
Parmi ses caractéristiques inédites, on peut noter
qu'elle doit impérativement être disponible sans
interruption, et habitée en permanence par un équipage
international. L'accès doit y être possible fréquemment
et de manière régulière. De plus, le complexe
orbital doit offrir des ressources en termes de capacités
de laboratoire, d'installations et de plates-formes extérieures,
de puissance, de télécommunications et de traitement
des données susceptibles de faire progresser la science
et de faire accélérer les innovations technologiques.
La Station Spatiale doit devenir un véritable institut
de recherche ultra-performant à l'entière disposition
de la communauté scientifique internationale où
des chercheurs pourront se consacrer en permanence à des
travaux scientifiques et technologiques dans le but d'apporter
des solutions inédites et novatrices à des problèmes
rencontrés sur Terre.
|
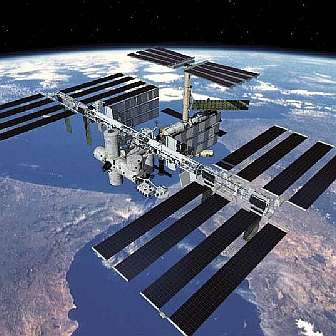
La Station Spatiale Internationale |
En gros, on peut dire que la Station Spatiale
Internationale est un gigantesque mécano de quelque 108
mètres de longueur sur 74 mètres de large et une
masse de quelque 415 tonnes lorsqu'elle sera terminée sur
orbite. Avec un volume habitable de plus de 1200 m³, elle
dépassera en complexité, et de loin, tout ce qui
a été conçu jusqu'à ce jour. Elle
pourra accueillir sept astronautes en permanence, qui se succéderont
et se relaieront selon les exigences des missions, et son énergie
sera fournie par les plus grands panneaux solaires qui aient jamais
été construits, d'une puissance de 110 kW.
|
L'architecture :
L'élément central de l'ISS est le module de fret
fonctionnel, connu sous l'abréviation de FGB. Construit
par la Russie mais financé par les Etats-Unis dont il reste
la propriété, il s'agit en fait d'un véhicule
autonome en charge de l'alimentation électrique, de la
régulation thermique, ainsi que de la navigation, la propulsion
et les télécommunications. Baptisé Zarya,
il a été mis en orbite le 20 novembre 1998 par un
lanceur Proton depuis Baïkonour.
Unity est le nœud central de la future station. Véritable
carrefour, il relie le FGB aux éléments suivants,
mais sert aussi d'appui au mât supportant les énormes
panneaux solaires. Comportant pas moins de six sas d'amarrage,
il a été construit par les Etats-Unis et placé
en orbite le 4 décembre 1998 lors de la mission STS-88
de la navette Endeavour.
|
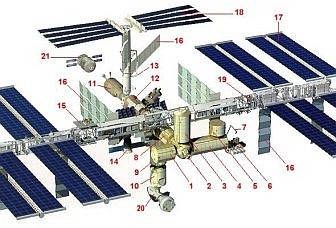
|
Ces deux éléments ont été
les premiers en orbite. Les autres éléments constitutifs
de la station peuvent être classés en sept catégories
en fonction de leur maître-d'œuvre respectif. C'est
ainsi que nous allons citer successivement L'Europe, les Etats-Unis,
la Russie, le Japon, le Canada, l'Italie et le Brésil.
|
La participation européenne
Le COF, ou Columbus Orbital Facility.
La partie européenne de la station est représentée
essentiellement par le module laboratoire européen, dénommé
Elément orbital Columbus (COF – Columbus Orbital
Facility). Extrêmement polyvalent, ce laboratoire à
usages multiples peut être adapté à différentes
missions par l'échange de bâtis normalisés
à bord, tout comme le avions de ligne à cabines
modulaires peuvent se reconfigurer pour différents usages.
Le COF sera le lieu de travail privilégié des astronautes
et chercheurs européens.
Ce module pressurisé sera raccordé en permanence
à la station, dont il fera partie intégrante, et
il en recevra toutes les ressources nécessaires. Ses utilisations
sont multiples, et portent entre autres sur la science des matériaux,
la physique des fluides, les sciences de la vie, la physique fondamentale
et de nombreuses autres technologies. Il renfermera aussi la plupart
des charges utiles pressurisées européennes.
Le COF se présente physiquement sous la forme d'un cylindre
accusant 9500 kg au lancement, mesurant 6,7 mètres sur 4,5
mètres. Raccordé au point de branchement numéro
2 (node 2), il en recevra sa puissance électrique sous la
forme de courant continu à 120 volts et d'autres ressources.
Sa consommation pourra aller jusqu'à 13,5 kW. |
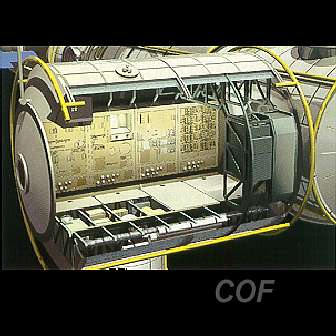
Vue intérieure du COF
|
Vu de l'extérieur, le COF est une coque
pressurisée cylindrique muni de deux cônes d'extrémité,
ainsi que de tourillons servant au transport et à la manutention
du module. Rigidifiée et recouverte de plusieurs couches
d'isolant thermique et d'un blindage de protection contre les
météorites ainsi que les débris spatiaux
de plus en plus nombreux, elle est en outre équipée
d'une structure d'accrochage sur la coque extérieure en
vue des opérations de manutention et d'assemblage au moyen
du bras télémanipulateur de la Station Spatiale
(SSRMS) pouvant aussi servir à la transmission de signaux
électriques et de données au moyen de relais intégrés.
|
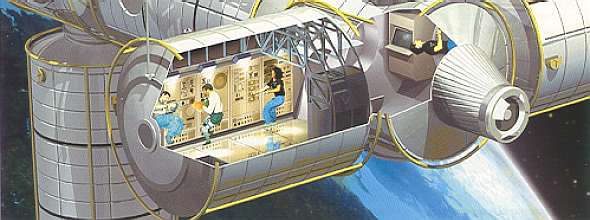
Le COF (Colombus Orbital Facility) européen,
vue sur l'aménagement intérieur.
Crédit ESA.
|
Le cône avant intègre la partie passive d'un mécanisme
d'accostage universel (CBM) qui permet la fixation au node 2.
Le cône arrière est prévu pour recevoir optionnellement
sa propre antenne de liaison et un équipement de télécommunications
autonome avec le sol via le système de relais de données
européen DRS. Dans la perspective d'une telle évolution
future, il pourrait aussi recevoir divers points d'accrochage
nécessaires au raccordement d'une plate-forme de charge
utile extérieure.
L'aménagement intérieur du module européen
est pluridisciplinaire et évolutif. Il a été
conçu à la manière d'une cabine d'avion de
ligne, de façon à pouvoir être transformé
et adapté en fonction des besoins par l'utilisation de
bâtis interchangeables. Ce bâtis, qui constituent
une évolution technologique majeure, sont dénommés
ISPR, pour International Standard Payload Rack. Ils peuvent être
acheminés vers la station, installés dan le module
puis, plus tard, en être extraits à n'importe quel
moment de la durée de vie opérationnelle de la station.
Du fait que les modules européen, américain et japonais
utilisent le même concept d'ISPR, les bâtis sont interchangeables
entre les laboratoires, à l'exception des laboratoires
russes qui n'ont pas adopté ce standard.
Le COF peut recevoir simultanément dix bâtis ISPR
de type scientifique comportant divers instruments et expériences
ainsi que trois bâtis de stockage d'équipements.
La capacité de chaque bâti est de 1,5 m³ pour
une charge maximale de 700 kg.
Le module laboratoire européen sera acheminé vers
la Station Spatiale Internationale dans la soute de la navette,
entièrement équipé, comprenant des bâtis
et leurs charges utiles initiales d'environ 2500 kg. Au terme
de sa vie opérationnelle, il pourra être ramené
au sol de la même façon. Le coût du lancement
fera l'objet d'un échange contre un vol d'Ariane 5 visant
la satellisation de l'ATV.
|
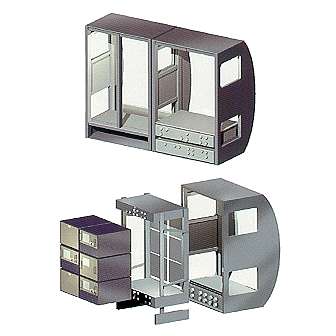
Bâtis normalisés interchangeables.
Communs à tous les modules de la Station Spatiale Internationale,
excepté la partie russe, ils en autorisent une très
grande souplesse dans l'aménagement interne.
En haut: bâti de charge utile internationale
normalisé.
En bas: concept de bâti express.
Crédit ESA.
|
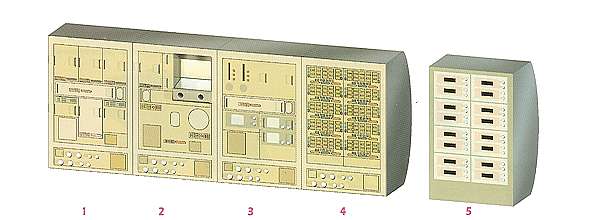
Concept d'aménagement initial retenu
pour le COF.
1, 2 et 3: bâtis configurés pour les programmes
de recherches de l'ESA et des agences nationales.
4: bâti express pour des expériences individuelles.
5: bâti de stockage.
Crédit ESA.
|

Installation de recherche en microgravité
à bord du COF.
De gauche à droite:
Modules européens de physiologie;
Laboratoire de sciences des fluides;
Biolab pour les expériences de sciences
de la vie;
Bâti de stockage.
Crédit ESA.
|
L'ATV, ou Automatic Transfer Vehicle
Bien qu'il ne reste pas fixé en permanence à la
Station Spatiale Internationale, l'ATV n'en est pas moins un élément
des plus importants.
L'ISS sera, ainsi qu'il a été décidé
dès le départ du projet, desservi par une flotte
mixte. Dans cette optique, l'Europe a décidé d'utiliser
son propre système de transport spatial: Ariane 5. Mais
conçue pour l'essentiel comme lanceur de satellite, Ariane
5 n'est pas équipée pour effectuer des manœuvres
de rendez-vous et d'accostage avec une station spatiale. Il lui
faut pour cela un complément "intelligent" possédant
l'avionique et les ressources nécessaires, c'est le rôle
de l'ATV (Automated Transfer Vehicle).
L'ATV n'est autre que le prolongement de l'étage supérieur
d'une Ariane 5. Il se présente donc sous la forme d'un
cylindre de 5,45 mètres de diamètre sur 2,5 mètres
de longueur. Il est équipé en standard d'un module
de propulsion composé de huit petits moteurs à réaction
et d'un module d'avionique qui intègre les réservoirs
d'ergols, les circuits électroniques ainsi que les systèmes
de régularisation thermique, de production d'énergie
et de télécommunications.
Trois configuration de base sont prévues pour l'ATV. Il
peut notamment recevoir un mini-module logistique pressurisé
(MPLM), une coque porteuse et deux palettes logistiques non pressurisées
(ULC), ou un module pressurisé en plus d'une structure
porte-réservoir ouverte.
Les charges utiles véhiculées par l'ATV se répartissent
en deux catégories: celles qui peuvent être exposées
au vide spatial et celles qui nécessitent d'être
transportées sous atmosphère contrôlée.
Dans le premier cas, sa capacité est de 9 tonnes de fret,
tandis que dans le second son emport est réduit à
6,7 tonnes. Les charges utiles ne nécessitant pas d'être
acheminées dans un module fermé seront montées
sur une structure ouverte de type "étagère",
comme ce sera le cas pour l'acheminement de réservoirs
d'ergols, de gaz ou d'eau. Il est aussi possible de combiner les
deux types de charges, pressurisée et non pressurisée,
sur un seul ATV.
|
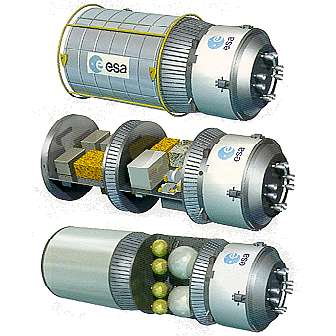
Automatic Transfer Vehicle (ATV) en trois configurations possibles.
De haut en bas:
ATV muni d'un mini-module logistique pressurisé (MPLM);
ATV équipé d'une coque porteuse et de deux porteurs
logistiques non pressurisés (ULC);
ATV équipé d'un module pressurisé et d'une
structure porte-réservoirs ouverte.
Crédit ESA
|
Mais là ne se limitent pas les possibilités
de ce véhicule de transport spatial.
L'ATV, équipé de ses moteurs et
d'une capacité d'ergols accrue, sera aussi utilisé
pour effectuer les modifications d'orbite de la station, et notamment
les "reboosts", c'est-à-dire les rehaussements
d'orbite destinés à en compenser l'usure. Au début
de la vie de l'ISS, ces "reboosts" seront assurés
par des vaisseaux-cargos de type Progress-M russes, mais l'utilisation
de l'ATV présente deux avantages essentiels :
Tout d'abord, la capacité d'emport de
l'ATV est pratiquement double par rapport au Progress-M, ce qui
implique que le nombre de missions sera deux fois moindre pour
un même résultat.
Ensuite, cette fonction de "reboost"
est considérée par la NASA comme un élément
d'infrastructure. Or, si le rehaussement d'orbite est assuré
par l'ATV, l'Europe devient fournisseur d'un élément
d'infrastructure et, à ce titre, obtient un part du quota
d'utilisation des éléments d'installation réservés
aux fournisseurs des éléments d'infrastructure.
En clair, cela signifie que l'Europe serait autorisée à
accroître les droits d'utilisation de son propre module
laboratoire au-delà de la base de départ de 51%.
Il faut aussi considérer que sans l'ATV,
le Progress-M serait le seul véhicule capable d'assurer
le rehaussement d'orbite. Or, pour des raisons aussi bien technologiques
que politiques, il est souhaitable de disposer de deux moyens
indépendants pour assurer cette fonction, particulièrement
vitale pour la station.
L'ATV est conçu pour rester amarré
à la station spatiale durant six mois. Dès qu'il
aura livré sa charge utile à bord, il sera utilisé
pour entreposer les déchets et autres résidus accumulés
en cours de mission, puis après désolidarisation,
pourra effectuer une rentrée destructive dans les couches
denses de l'atmosphère terrestre, où il se consumera.
|
L'ERA, ou European Robotic Arm
Le bras manipulateur européen est bâti sur un concept
tout-à-fait original et unique qui en fait un engin d'exception
très différent du bras manipulateur principal de
la station ou de son homologue de la navette spatiale américaine.
A chaque extrémité de ce manipulateur symétrique
de 10 mètres se trouve un organe préhenseur identique.
Son utilisation alternée en tant que "pied" et
"main" permet au bras de se déplacer d'un point
d'ancrage à un autre à la manière d'une chenille
arpenteuse. Ces organes sont conçus pour saisir et relâcher
des charges utiles équipées d'un dispositif standard
d'accrochage, pour mesurer des forces et des couples, ainsi que
pour transmettre des signaux électriques, de donnés
ou de vidéo des charges utiles qu'ils ont saisies. Ces
organes préhenseurs sont aussi équipés d'un
outil de service intégré que l'on pourrait comparer
à un tournevis universel. Il peut également recevoir
une plate-forme comportant cale-pieds et mains courantes et transporter
des astronautes lors de sorties extra-véhiculaires.
L'ERA sera mis en œuvre à partir d'un dispositif
d'ancrage monté sur une petite plate-forme mobile capable
de se déplacer le long de rails longeant la structure de
la plate-forme russe scientifique et d'énergie. En se déplaçant
d'un point d'ancrage à un autre, répartis sur d'autres
élément de la station, l'ERA élargit considérablement
sa zone d'intervention.
Le bras manipulateur européen est conçu pour être
aussi bien commandé par un astronaute en activité
extra-véhiculaire que pour être activé depuis
l'intérieur de la station. Toutes ses tâches peuvent
être pré-programmées, de sorte qu'il suffit
de les lancer puis de contrôler visuellement son action.
Le coût de la participation européenne est actuellement
estimé à 3 milliards de dollars.
|
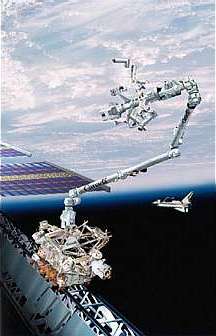
Système d'entretien mobile de la Station.
Crédit ESA.
|
Les Etats-Unis
En leur qualité d'initiateurs du projet, les Etats-Unis
joueront le rôle principal dans son élaboration et
c'est sans surprise que l'on peut constater que la majeure partie
de l'ISS leur appartient.
Le module de service Zarya et le Node-1 Unity
ayant déjà été décrits, passons
en revue les éléments suivants, en commençant
par les modules habitables.
Le laboratoire scientifique américain
Il s'agit d'un module pressurisé, habitable, conçu
pour accueillir les charges utiles et les expériences devant
s'accommoder d'une atmosphère terrestre. Sa capacité
est de 24 racks modulables, dont 13 sont spécialement conçus
pour recevoir des expériences nécessitant un interfaçage
complet avec la station et ses ressources.
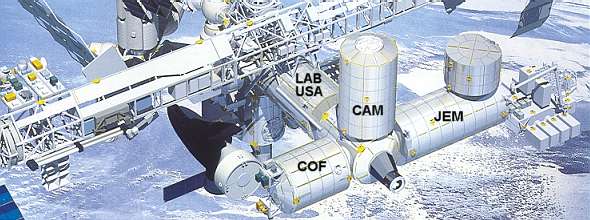
Emplacements respectifs du laboratoire scientifique américain
(LAB USA), de la centrifugeuse (CAM), du COF et du JEM (laboratoire
japonais).
Crédit NASA.
Parmi les premiers éléments
à être installés dans ce laboratoire américain,
on peut citer notamment:
Material Science Research Design Facility
Ce rack comprend un élément central qui coordonne
la collecte et le traitement des données, ainsi que l'enregistrement
et la redistribution d'images vidéo, ainsi que deux ensembles
de contrôle de la température et de l'environnement
des échantillons à traiter dans diverses expériences.
|
Microgravity Science Glovebox
Il s'agit d'une boîte de manipulation à gants utilisée
pour la manipulation d'échantillons en évitant toute
contamination, telle qu'on en trouve dans tout laboratoire de
biologie terrestre.
Fluids and Combustion Facility
Ce triple rack, conçu par le Lewis Research Center de la
NASA, est conçu pour l'étude de la physique des
fluides (liquides, gaz et mélanges) et de la combustion
en apesanteur. Il comprend une chambre de combustion, des dispositifs
de dosage des gaz et des liquides, ainsi que divers systèmes
très élaborés d'éclairage, de polarisation,
de prise de vues et tous leurs automatismes incluant l'enregistrement
vidéo sous forme digitale.
Biotechnology facility
Ce rack comporte six sous-ensembles interchangeables et modulables
selon les expériences en cours. Ses éléments
seront utilisés dans de nombreuses occasions, qu'il s'agisse
de cultures cellulaires, de croissance de cristaux, études
des protéines, séparations biochimiques, micro-encapsulation.
Chacun de ses sous-ensembles est énergétiquement
autonome et peut être alimenté sous différentes
atmosphères (oxygène, nitrogène, dioxyde
de carbone et argon). Il comporte son propre système informatique
et un dispositif indépendant de prises de vues.
Window Observational Research Facility
Cet élément un peu particulier comporte un hublot
pratiqué dans la paroi du module laboratoire équipé
d'un verre de qualité optique. Il peut recevoir différents
instruments dédiés à l'observation de la surface
terrestre et sera utilisé notamment pour l'étude des
continents ou des phénomènes atmosphériques.
|
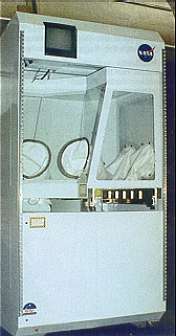
Microgravity Science Glovebox. Boîte de
manipulation à gants pour la manipulation d'échantillons
sans contamination. Crédit NASA.
|
X-Ray Cristallography Facility
Double rack consacré à l'étude des cristaux
en apesanteur. La croissance, la multiplication des cristaux peut
être étudiée à l'intérieur des
cuves de conditionnement de ce dispositif, qui possède
un système ultra-perfectionné de manipulation robotisée
pilotée par l'équipage, par un ordinateur ou encore
par des techniciens au sol. Tous les systèmes de prises
de vues et d'analyses, aussi bien chimiques que spectrométriques
en lumière visible ou en rayons X sont inclus dans cet
élément.
Minus Eighty degrees Celsius Laboratory Freezer for the
ISS
Le Minus Eighty degrees Celsius Laboratory Freezer for the ISS
(MELFI) a été construit par l'European Space Agency
(ESA) sous la direction de la NASA. Il comprend trois unités
de vol assurant le transport d'échantillons entre le sol
et la station spatiale pouvant prendre place aussi bien dans la
soute de la navette que dans le laboratoire scientifique. Ces
racks comportent quatre unités de réfrigération
autonomes pouvant assurer des températures régulées
de -80°C, -26°C et +4°C.
La Centrifugeuse
Le Centrifuge Accommodation Module (CAM) se présente sous
le même gabarit que le laboratoire scientifique, dont il
partage la même interface et les mêmes ressources.
Le CAM est construit par l'Agence Spatiale Japonaise (NASDA) sous
contrat avec la NASA. Sa fonction, comme son nom l'indique, est
d'étudier l'effet de différents niveaux de gravité
(de 0,01g à 2g) sur la structure et la fonction de plantes
ou d'animaux obtenus en microgravité.
Il est composé d'une centrifugeuse consistant
en un rotor de 2,5 mètres de diamètre, comportant
de nombreux emplacements d'expériences et son propre système
de contrôle. Ce rotor, caréné, est disposé
en bout d'élément.
Deux racks sont présents à bord
du CAM:
Life Science Glovebox (LSG) est une boîte
à gants biologique spécialement conçue pour
l'étude du vivant.
Habitat Holding Racks (HHRs) fournit les supports
d'expériences ayant trait à la science du vivant,
y compris l'énergie électrique, les transmissions
de données et divers autres équipements scientifiques.
|
Le module d'habitation
Bien que n'ayant aucune fonction scientifique, cet élément
est considéré comme capital aux yeux de l'équipage
puisqu'il devrait constituer leur habitat privé durant
plusieurs mois. Cependant, une récente décision
de l'administration Bush Jr en a annulé le lancement pour
raisons d'économie...
Conçu pour assurer un maximum de confort à six
personnes, en leur garantissant toute l'hygiène voulue
(toilettes, douche en apesanteur) ainsi que l'équipement
indispensable aux soins de santé et du corps en général,
il aurait du aussi abriter les réserves alimentaires dans
ses frigos et congélateurs, ainsi que de la nourriture
lyophilisée et les moyens de la réhydrater. Ce module
avait été pensé afin d'assurer aussi un minimum
d'intimité à chacun des membres de l'équipage.
La liste serait incomplète si nous ne citions
pas encore :
Le sas de sortie
Elément à part entière, celui-ci est fixé
au Node-1 déjà en orbite. Comme son nom le révèle,
sa fonction sera de permettre le passage entre l'intérieur,
pressurisé, de la station, et le vide spatial. Il est étudié
pour recevoir des astronautes équipés aussi bien
de l'Extravehicular Mobility Unit (EMU) américain que du
Russian Orlon EVA, son équivalent russe. Deux astronautes
peuvent y prendre place simultanément.
|
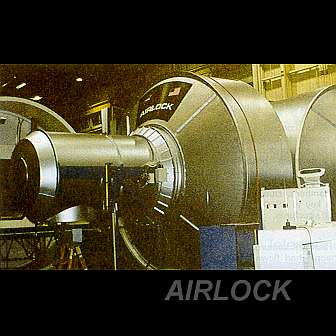
Le sas de sortie (Airlock). Crédit NASA.
|
| La coupole
Il s'agit d'une baie vitrée de forme convexe
et circulaire, composée d'une mosaïque de sept hublots,
soit un hublot central de forme circulaire entouré de six
autres plus petits et trapézoïdaux. L'ensemble, fixé
sur le Node-1 du côté opposé au sas de sortie,
fournit une vue panoramique vers le bras manipulateur canadien et
sera largement employé lors de différentes opérations.
Gageons que plus d'un astronaute y passera aussi un peu de son temps
libre…
Le véhicule de transfert
Le rôle de véhicule de transfert et
de retour d'équipage sera tenu dans un premier temps par
un vaisseau Soyouz russe. Cependant, un engin spécifique,
basé sur le X-38 expérimental de la NASA, aurait dû
être développé dans ce but. Il n'en sera rien,
ce projet ayant rejoint le module d'habitation dans les oubliettes
de l'Histoire pour raisons d'économie, suite à une
décision de l'administration Bush Jr.
Ce X-38, dont le premier modèle de vol devait
être testé depuis une navette spatiale en 2001, était
capable d'abriter jusqu'à six personnes, alors que le Soyouz
ne peut en recevoir que trois. Spécialement adapté
à une évacuation d'urgence, il pouvait fonctionner
de façon entièrement automatique, tant en ce qui concerne
le désamarrage, que la rentrée dans l'atmosphère
et même l'atterrissage sur un site spécifiquement désigné.
|

Vue imprenable sur la Terre depuis la coupole de la Station
Spatiale Internationale. Crédit ESA.
|
La poutre et les panneaux
solaires
Il s'agit incontestablement de la partie la plus
spectaculaire de la Station Spatiale Internationale.
Assemblés en plusieurs étapes, ces
gigantesques générateurs électriques sont les
plus grands qui aient jamais été construits. Ils fourniront
en moyenne jusqu'à 110 kW à la station.
Disposés en deux groupes, Tribord S et Bâbord
P comprenant chacun un ensemble de huit panneaux, chacun d'entre
eux ne mesure pas moins de 40 x 13 mètres. A chaque groupe
de panneaux est associé un ou plusieurs radiateurs-dissipateurs
de chaleur.
L'ensemble est disposé de part et d'autre
d'une poutre de plus de 100 mètres de longueur, fixée
en son centre au sommet du Node-1 Unity par un élément
intermédiaire.
Le coût de la participation américaine
est actuellement évalué à 32 – 36 milliards
de dollars.
|
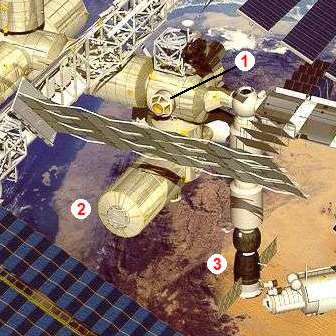
1. La coupole.
2. Le module d'habitation américain (incertain).
3. Véhicule de transfert (ici un Soyouz).
Crédit ESA.
|
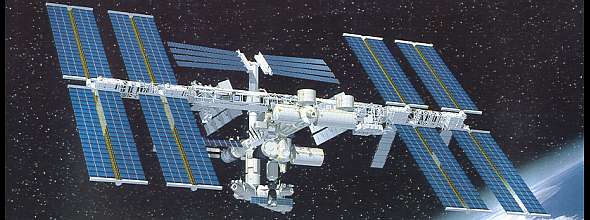
Les panneaux solaires de la Station Spatiale
Internationale en sont certainement l'élément le plus
spectaculaire.
Crédit NASA.
|
La Russie
La participation de la Russie dans la réalisation
de la Station Spatiale Internationale est loin d'être symbolique,
même si elle est loin d'être définie, du moins
complètement. En effet, si on examine une représentation
de l'ISS, on s'aperçoit que la partie russe s'apparente plus
à "une station dans la station" qu'à une
simple annexe...

Section russe
1. Module d'accostage multiple.
2. Module d'habitation.
3. Laboratoire.
4. Vaisseau Soyouz (ou Progress).
Section internationale
5. Module de service.
6. ATV (Automatic Transfer Vehicle) en configuration de poussée.
7. Module de contrôle (Zarya).
8. Airlock (sas de sortie dans l'espace).
9. ATV (Automatic Transfer Vehicle) en configuration de transfert
de matériaux.
Sans conteste, le générateur électrique
en sera la marque la plus visible. Composé de huit panneaux
solaires fixés au bout de leur propre mât de près
de 20 mètres trouvant ancrage sur le module de service Zvezda,
il assure l'autonomie énergétique de toute la section.
Au module de service, sur le sas opposé
au mât et dirigé vers le nadir (c'est-à-dire
vers la Terre) s'amarrera un module d'accostage multiple, très
similaire à celui utilisé actuellement sur Mir. Et
à cet élément viendront se fixer deux modules
laboratoires, un module d'habitation et un sas d'amarrage universel
pouvant notamment recevoir les vaisseaux de ravitaillement Progress.
L'ensemble sera prolongé par un vaisseau Soyouz pouvant faire
office de "barque de sauvetage" dans l'attente du développement
d'un moyen d'évacuation plus approprié.
|
Sans conteste, le générateur
électrique en sera la marque la plus visible. Composé
de huit panneaux solaires fixés au bout de leur propre mât
de près de 20 mètres trouvant ancrage sur le module
de service Zvezda, il assure l'autonomie énergétique
de toute la section.
Au module de service, sur le sas opposé
au mât et dirigé vers le nadir (c'est-à-dire
vers la Terre) s'amarrera un module d'accostage multiple, très
similaire à celui utilisé actuellement sur Mir. Et
à cet élément viendront se fixer deux modules
laboratoires, un module d'habitation et un sas d'amarrage universel
pouvant notamment recevoir les vaisseaux de ravitaillement Progress.
L'ensemble sera prolongé par un vaisseau Soyouz pouvant faire
office de "barque de sauvetage" dans l'attente du développement
d'un moyen d'évacuation plus approprié.
Mais l'état de délabrement actuel
de l'économie russe empêche de pousser plus loin la
définition du projet, dont le coût est estimé
à 6 – 10 milliards de dollars. |
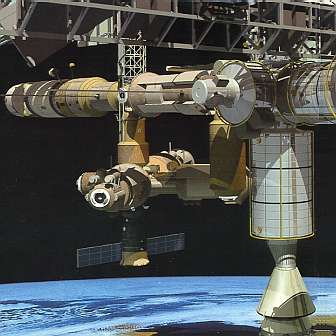
Vue sur la section russe de la Station Spatiale Internationale,
un vaisseau cargo Progress y est ici arrimé. Crédit
ESA.
|
Le Japon
Le Japanese Experiment Module (JEM) est la pièce maîtresse
du Japon sur la Station Spatiale Internationale. Fourni par l'Agence
Spatiale Japonaise (NASDA), il comporte dix emplacements normalisés
à bord, dont cinq seront occupés par des racks de
charge utile japonais et cinq autres par du matériel de la
NASA. Tous les emplacements sont compatibles aux standards internationaux
en ce qui concerne les branchements énergétiques et
l'approvisionnement en divers gaz ou liquides.
Le JEM inclut le Experiment Logistic Module –
Pressurized Section (ELM PS), cylindre également pressurisé
fournissant des emplacements supplémentaires pour certaines
expériences réclamant, entre autres, une atmosphère
ou une pression atmosphérique différentes. Cet élément
est fixé perpendiculairement au JEM.
Experiment Logistic Module – Exposed Section
(ELM ES) est une palette prolongeant l'élément principal,
destiné à recevoir les instruments et expériences
devant être exposés au vide spatial. Un sas en facilite
l'accès.
Le module japonais possède également
son propre bras manipulateur, avec l'avantage de limiter le nombre
d'interventions humaines à l'extérieur.
Le coût de la participation japonaise est
estimé à 3,8 milliards de dollars.
Le Canada
Le Canada, fort de son expérience à bord de la navette
spatiale américaine, se charge de fournir le bras manipulateur
principal de la station spatiale. Long de près de 20 mètres,
il est capable de déplacer des charges de 125 tonnes et sera
largement utilisé dans la phase de construction de la station.
Deux ans après son installation, une "main" beaucoup
plus précise y sera adaptée, autorisant des travaux
exigeant une grande dextérité.
L'Agence Spatiale Canadienne construira aussi une
plate-forme mobile d'inspection et de maintenance, petit véhicule
inhabité entièrement autonome télécommandé
depuis la station et qui sera capable de parcourir l'ensemble de
la structure en relayant images et données aussi bien vers
le centre de contrôle à bord que sur Terre.
Coût estimé : environ 1 milliard de
dollars.
L'Italie
Bien que faisant partie de l'European Space Agency (ESA), l'Agence
Spatiale Italienne (ASI) a choisi d'ajouter une participation personnelle
et indépendante à la construction de la Station Spatiale
Internationale. L'Italian Multi-Purpose Laboratory Modules (MPLMs)
est un élément construit sur le modèle du COF
(Colombus) européen et abritera 16 emplacements normalisés
aptes à recevoir des charges italiennes, européennes
ou américaines. Son lancement sera assuré par la navette
spatiale.
L'ASI construit également les Node-2 et
Node-3 pour le compte de la NASA.
Le Brésil
L'Instituto de Nacional Pesquisas Espaciais est en charge de l'élaboration
et la construction d'un système de palettes porteuses mobiles
à instruments qui se fixeront sur la poutre principale de
l'ISS, et sur laquelle pourront être installées diverses
charges devant rester exposées au vide spatial.
|
|



